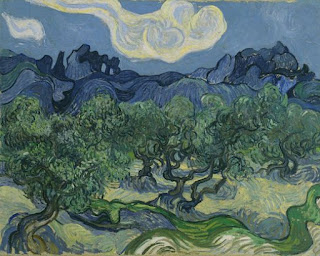On commence par des expos avec une journée au musée de l'Homme ! Oui, c'était pendant l'été, la plupart des expos sont terminées.
Je mange donc je suis
Mangez avant d'aller voir cette expo, elle risque de vous donner faim. On y parle d'alimentation, de cuisine, de nourriture bien entendu. Tout commence avec nos goûts et un rapide retour sur l'alimentation préhistorique puis on découvre des éléments culturels, sociaux et religieux. Car manger nourrit le corps mais aussi l'esprit à travers des rites. C'est aussi un élément social et culturel, de la cuisine à la table, qui parle de nos quotidiens. Enfin, un dernier temps est consacré à la production de la nourriture, challengeant nos perceptions de ce qu'on mange : est-ce que c'est mieux bio, local ou autres ? Est-ce qu'on est prêt à manger des insectes ou de la nourriture lyophilisée ?
Expo intéressante, partant un peu tous azimuts, à trop embrasser, elle ne saisit pas grand chose. Tout est survolé. C'est une porte d'entrée qui donne envie de développer des dizaines de sous-expos autour de la nourriture-culture, de la nourriture-sociale, de la nourriture-religieuse, de la nourriture-produit, de la nourriture-future...
Dernier repas à Pompéi
Après "Je mange donc je suis", une expo dédiée à la nourriture à Pompéi, montrant essentiellement des restes d'aliments carbonisés. Organisée comme une domus avec ses pôles liés au repas : taberna, culina et triclinum, l'expo présente des denrées alimentaires avec quelques recettes, laissant entrevoir une partie de la gastronomie romaine.
Etre beau
Expo photo rapide sur la norme, le handicap et l'image de soi par Frédérique Deghelt, écrivaine et Astrid di Crollalanza, photographe. Un peu trop courte !
Puis petit tour à l'ouest avec trois expos bien différentes.
A Capella
Etonnant de voir un street artist exposé dans une chapelle ! C'est le cas de Seth à Saint Malo. Photos d'œuvres en Chine, en Inde et ailleurs, toiles, installations, carnets de voyages, tous types de médias sont présentés. J'ai aimé les clins d'yeux constants entre les installations, les photos, les objets, qui permettent d'entrer dans un univers.
Archipel, Fonds de dotation Jean-Jacques Lebel à Nantes
L'expo du musée des beaux-arts de Nantes est celle d'une collection qui part tous azimuts. Oeuvres du 20e et 21e siècles, regroupées par artiste ou par courant artistique, elles forment des archipels d'art. On part à la découverte d'œuvres du surréalisme, dadaïstes, de Fluxus etc. Rien de bien marquant si ce n'est la richesse de la collection.
Raoul Dufy (1877-1953), les années folles
Au musée des beaux arts de Quimper, j'ai pu découvrir des oeuvres de Dufy issues d'une collection particulière. La première partie s'attache surtout à des paysages, bords de mer, scènes parisiennes tandis que la suite tourne autour de la couture et des arts décoratifs. Je me suis régalée de ses motifs, utilisés en couture !
Un petit tour au Palais de Tokyo pour découvrir des expos qui m'ont laissée sur ma faim.
Ulla von Brandenburg : Le milieu est bleu
Jeu de rideaux et d'apparence, façon théâtre, de tissus, de couleurs franches, de nasses à poissons géantes, de personnages étranges, jusqu'à un genre d'opéra entre scène et forêt, j'avoue n'y avoir rien compris. Mais j'ai trouvé ça plutôt joli... Ce qui n'est pas assez pour apprécier une expo malheureusement.
Notre monde brûle
Cela raisonne écologie, non ? Eh bien pas seulement. C'est aussi une réalité politique, celle des printemps arabes, des guerres, des migrations qui est au cœur de cette expo. Oeuvres d'artistes variés, du Moyen Orient et d'Afrique, dialoguent. Il y est question de perte, deuil, pillage et déplacement, de colonisation et d'influence. Seul regret, assez peu de dialogue entre certaines œuvres.
Après les musées, passons aux salles obscures...
Tenet
Tout le monde a déjà parlé du film de Nolan, non ? J'ai aimé les jeux sur le temps et l'entropie, ça fait un peu mal à la tête mais c'est bien pensé. Et c'est un bon film d'action. Mais beaucoup moins bluffant qu'un Inception pour moi.
Le capital au XXIe siècle
Je n'ai toujours pas lu la somme de Piketty, qui reste sagement sur ma PAL, mais j'ai vu le film. C'est un documentaire agréable à regarder, facile d'accès et qui investit sur la culture pop et ciné pour faire comprendre les inégalités. Des paroles d'experts viennent étayer tout cela, historiquement et économiquement. Malheureusement, il manque d'éléments économiques et de propositions concrètes à mes yeux. Disons que c'est un bon appetiser !
En Avant
Sympathique petit dernier de Disney qui met en scène un monde où la magie disparait. Deux frères se mettent en quête de cette magie pour retrouver leur père. Touchant et drôle, un bon mélange !
Adolescentes
Emma et Anaïs sont deux adolescentes de 13 ans. Amies, elles vont au même collège à Brive. Elles seront suivies par le réalisateur jusqu'à leurs 18 ans. Au-delà de la vie personnelle des deux jeunes filles, ce sont leurs familles et leurs milieux sociaux qui transparaissent à l'écran. J'avoue m'être plutôt ennuyée devant ce documentaire, malgré quelques rires. Les garçons qui m'accompagnaient ont bien aimé.
West Side Story de l’Amazing Keystone Big Band au Bal Blomet
Premier concert depuis le confinement. Que ça fait du bien ! Surtout quand l’Amazing Keystone Big Band propose une réécriture de West Side Story. Un ensemble de 17 musiciens, tous meilleurs les uns que les autres, qui rajeunit et jazzifie la comédie musicale avec trois chanteurs épatants et un conteur. Voilà qui donne envie d'aller plus souvent dans cette magnifique salle !