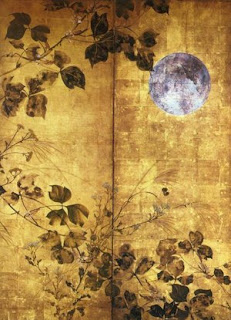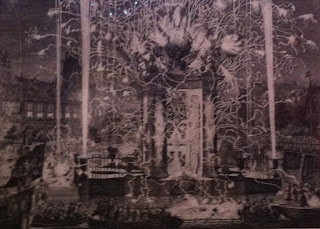Gaudé et moi, c'est une histoire d'amour ! Franchement, j'adore son écriture épique, ses personnages multiples, son goût de l'antique... Avec ce titre, je retrouve tous les ingrédients pour passer un excellent moment de lecture.
Six personnages, différents temps de combats et de guerre, dans des lieux divers. Hannibal, de l'Espagne à l'Italie avant le retour à Carthage. Assem, espion français. Mariam, archéologue des zones de guerre. Le général Grant durant la guerre de Sécession. Le Negus, Haïlé Sélassié, chassé d'Ethiopie. Sullivan, cet américain qui a traqué Ben Laden. Et qu'Assem doit à son tour neutraliser. Mais c'est aussi tous ces guerriers, ceux de la guerre de Troie, évoqués, c'est Antoine, dans l'épigraphe, c'est ceux qui n'ont pas laissé de nom et de traces.
Certains personnages se croisent donc. C'est Assem et Mariam, lors d'une étreinte d'une nuit, furtive mais marquante. C'est Sullivan (dit Job) et Assem, qui se parlent dans un hall d'hôtel.
Mariam, qui travaille pour l'Unesco et les musées d'Irak. Qui cherche des objets sauvés des pillages. Qui donne des visages et des objets à l'Histoire, pour qu'elle puisse se raconter. Elle lutte, avec ses petites armes, contre la destruction et l'oubli qu'imposent les djihadistes. Elle tente de sauver des hommes, comme le gardien du site de Palmyre. Et peut-être, de se sauver elle-même ?
"Ce qui reste, c'est ce qu'elle cherche, elle. Non plus les vies, les
destins singuliers, mais ce que l'homme offre au temps, la part de ce
qu'il veut sauver du désastre, la part sur laquelle la défaite n'a pas
de prise, les geste d'éternité. Aujourd'hui, c'est cette part que les
hommes en noir menacent [...] Ce qui se joue là, dans ces hommes qui éructent, c'est la jouissance de pouvoir effacer l'Histoire"
"J'imagine qu'il a parlé de l'importance de ne pas oublier que nous sommes des pilleurs de tombes. Que les pharaons se sont enfermés dans leur tombeau pour l'éternité et que nos ouverture, nos effractions, même au nom de l'Histoire, restent des intrusions de forbans. Il ne faut pas l'oublier. Nous construisons une science, nous sommes rigoureux, nous étudions dans les bibliothèques, nous parlons de patrimoine, de l'Histoire, de la mémoire des civilisations, mais il ne faut pas taire cette chose-là : le plaisir de l'effraction. Les squelettes, les momies, les objets funéraires, nous les volons au néant. Nous ouvrons des salles qui devraient rester fermées. Hier c'était à la dynamite, aujourd'hui c'est avec une infinie précaution, mais malheur à celui qui oublie que le geste est le même"
Assem est fatigué. Il a mené bien des missions et celle-ci ne l'inspire pas. Il connait bien la guerre mais il sent aussi qu'il se perd.
"Il voulait être dans l'Histoire - pas reconnu par elle (il n'a pas cette ambition) mais la sentir, être dans les endroits du monde où elle se cherche, se convulse, hésite, prend des formes effrayantes, démesurées. Sentir son souffle, voir comment elle modèle des pays, déforme des vies, crée des espaces singuliers"
Sullivan aimait la guerre. Et puis, il a vu des choses qui l'ont déchiré. Qui l'ont fait sortir du rang. Et maintenant, c'est une menace.
Et tous ces généraux, ces rois, ces guerriers, Hannibal, Grant ou le Négus, ce sont des héros, des incontournables de l'histoire. On les suit dans les combats, au milieu de leurs hommes, dans les charniers d'une fin de journée de massacre. On les rejoint dans leurs moments de doute ou de bravoure, de solitude. Et même vainqueurs, ils sentent bien qu'il perdent...
"On ne peut partir au combat avec l'espoir de revenir intact. "Souviens-toi de Mycènes..." Au départ, déjà, il y a le sang et le deuil. Au départ, déjà, il faut accepter l'idée d'être amputé de ce qui vous est le plus cher. Au départ, déjà, la certitude qu'il n'y aura aucune victoire pleine et joyeuse"
"La seule chose qui les différencie des confédérés, c'est la cause. Ce n'est pas rien. Il faut s'accrocher à cela. Le reste va être sale. Les hommes vont se tuer à grande échelle et il va falloir tenir. Les soldats, quel que soit leur camp, vont plonger dans le feu et la mêlée et ils découvriront avec stupeur la face immonde du meurtre"
"Certains hommes font la guerre à condition qu'elle ne les touche pas. Ils acceptent de mettre leur vie dans la balance, oui, mais pas celles de leur femme, de leurs enfants, pas les caves pleines d'amphores d'huile et de vin de leur région, pas les belles bâtisses dont ils ont hérité. Flaminius est de ceux-là. Hannibal le sent. Il va mettre à feu et à sang cette région, et le Romain perdra son sang-froid et sa clairvoyance"
"Autour de lui, les hommes commencent à pleurer. Pas à chanter, pas à hurler de joie : à pleurer sur leur propre victoire"
Un roman dur, pour ses descriptions des combats, pour les douleurs des guerriers, lucides sur leur sort et celui de leurs hommes, défaits par la violence, le sang, les armes. Mangés par la guerre. Mais beau par son écriture, par les portraits en creux de ces héros qui n'en sont pas, mais qui sont vus comme des justes ou des barbares, sans nuance, alors que Gaudé nous détache
de cette vision simpliste, par les réflexions sur l'histoire et son écriture, sur les combats de civilisations, qui font pencher les balances de l'histoire.